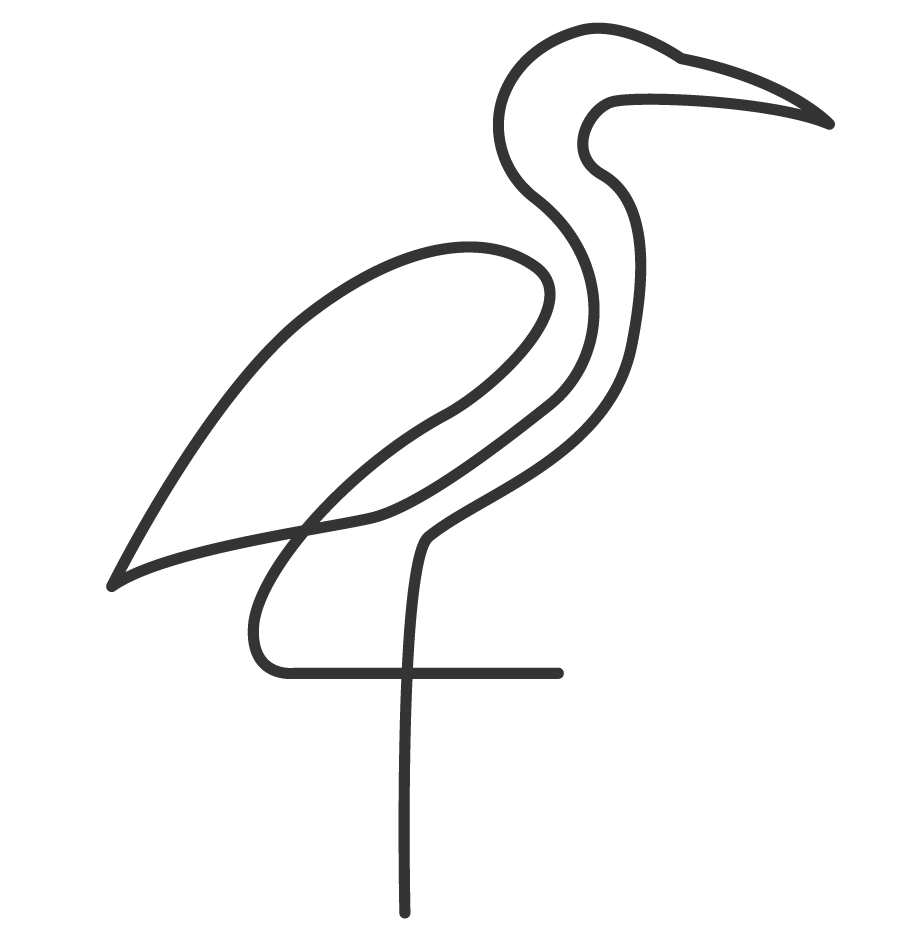L’angoisse traverse toute existence humaine. Elle surgit là où le sens se dérobe, là où le sujet se sent menacé dans son être, même sans danger extérieur clairement identifié. Elle n’est pas seulement une émotion passagère : elle touche au cœur même de la condition humaine.
D’un point de vue clinique, elle se distingue de l’anxiété. Là où l’anxiété s’attache à des objets précis (une situation, une menace identifiable), l’angoisse se manifeste souvent sans cause apparente, comme un fond qui envahit l’expérience. Elle peut apparaître brutalement, se maintenir sourdement, ou s’accompagner de symptômes corporels et psychiques intenses.
Philosophes et cliniciens, de Kierkegaard à Freud, en passant par les psychiatres contemporains comme Vassilis Kapsambelis, ont interrogé cette expérience énigmatique. Tous s’accordent pour dire qu’elle dit quelque chose d’essentiel de l’existence humaine, de ses limites, mais aussi de son rapport au désir et au manque.
Ce dossier propose d’explorer l’angoisse dans ses différentes dimensions – philosophique, clinique et psychanalytique – afin de mieux en saisir la logique et d’en approcher les formes.
Angoisse et anxiété : quelle différence ?
L’angoisse et l’anxiété sont deux notions souvent confondues, et leurs usages ont évolué au fil du temps. L’étymologie et la tradition historique ont conduit, pendant une grande partie du XXᵉ siècle, à utiliser le terme « angoisse » pour désigner les manifestations corporelles, tandis que « anxiété » renvoyait à des expériences mentalisées, pensées ou représentations internes.
Aujourd’hui, cette distinction est moins systématique. On peut dire que l’anxiété se rapporte davantage à des manifestations mentales et psychiques, et l’angoisse à une expérience plus diffuse, existentielle. Héritière de la peur, l’angoisse humaine s’est enrichie d’une organisation mentale dotée de mémoire, de représentations et de moyens symboliques.
La peur, quant à elle, est généralement liée à un objet précis, externe ou interne. Elle est universelle chez les mammifères et répond à un danger phylogénétique. L’angoisse humaine, elle, peut surgir en l’absence de menace externe, ou se rapporter à nos propres désirs et pulsions. Ainsi, on peut avoir peur de soi-même autant que de l’environnement.
Kapsambelis souligne que « certains usages de l’angoisse la rendent utile, certaines absences d’angoisses sont dangereuses », et que l’angoisse peut être mentalisée, rattachée à des images ou des idées. Elle se manifeste de façon circonstancielle, latente ou paroxystique, selon les individus et les contextes.
Les racines philosophiques de l’angoisse
L’angoisse a été étudiée tardivement en philosophie. Kierkegaard (1813-1855), dans Le Concept de l’angoisse (1844), la relie à la liberté et à la notion du possible : « Dans chaque état le possible est présent et dans la même mesure l’angoisse. » Pour lui, l’angoisse est subjective et traduit l’acceptation de l’indétermination de l’existence, le vertige face au choix.
Les phénoménologues et existentialistes, comme Heidegger, poursuivent cette réflexion : l’angoisse se rapporte à l’expérience du « rien » ou du « nulle part », révélant la liberté et la responsabilité radicale de l’homme. Sartre (1946) rejoint cette approche en affirmant que « l’homme qui s’engage… ne saurait échapper au sentiment de sa totale et profonde responsabilité », ce qui génère une angoisse inhérente à l’existence humaine.
L’émergence clinique et psychopathologique
C’est au XIXᵉ siècle que l’angoisse apparaît comme objet de la clinique. Pierre Janet (1859-1947), psychologue et médecin, distingue différentes formes d’angoisse et d’anxiété, en lien avec la psychopathologie. La distinction entre manifestations physiques (« angoisse ») et manifestations mentales (« anxiété ») a évolué, mais reste utile pour la compréhension clinique.
Ainsi, l’angoisse est universelle, présente à tous les âges et dans toutes les situations, mais sa forme et son intensité varient selon le contexte, les expériences et la constitution psychique du sujet. Elle est souvent le moteur qui pousse le sujet à consulter, à se regarder de l’intérieur et à interroger le sens de son existence.
Les symptômes de l’angoisse : corps, esprit, comportement
Les manifestations cliniques de l’angoisse peuvent être décrites selon trois registres :
1. Le syndrome physique : mobilisation neurovégétative, palpitations, vertiges, troubles respiratoires (dyspnée, halètement), troubles digestifs (nausées, diarrhée), troubles musculaires (tremblements, contractures), sueurs, sécheresse des muqueuses, hyperesthésie sensorielle, troubles du sommeil et des conduites alimentaires.
2. Le syndrome mental : sentiment d’inquiétude, appréhension, peur, effroi, panique. L’angoisse est inefficace, car elle ne se fixe pas sur un objet précis et tend à le créer plutôt qu’à le trouver. Elle engendre des doutes, incertitudes, indécisions et attente de l’inconnu.
3. Le syndrome comportemental : agitation, déambulation, crispation, sidération, crises de larmes ou « crises de nerfs ». La vie quotidienne s’organise autour de la crainte de revivre une crise, parfois avec des conduites d’évitement ou phobiques.
Kapsambelis rappelle que les troubles anxieux sont fréquents : une personne sur six présentera un syndrome anxieux au cours de sa vie, et l’angoisse est sensible à la présence rassurante d’autrui.
Freud et la psychanalyse de l’angoisse
Freud place l’angoisse au centre de la psychopathologie. Elle n’est pas un symptôme ordinaire : c’est ce qui reste quand l’affect n’est plus lié à une représentation consciente. L’énergie libidinale libérée par le refoulement peut se manifester de trois manières : répression, fixation sur de nouvelles représentations, ou transformation en angoisse.
Deux théories freudiennes de l’angoisse se complètent :
- L’angoisse de pulsion (décharge) : l’accumulation de libido non satisfaite génère une décharge sous forme d’angoisse.
- L’angoisse signal : l’angoisse sert de signal au moi pour déclencher des mécanismes défensifs, évitant l’envahissement par l’énergie pulsionnelle.
D’autres modèles psychanalytiques, comme l’angoisse de la naissance (Otto Rank), l’angoisse paranoïde (Mélanie Klein) ou l’angoisse d’effondrement (Winnicott), prolongent cette réflexion.
Trois formes majeures d’angoisse : avoir, être, perdre
On peut distinguer trois formes majeures :
- L’angoisse de l’avoir : liée à la frustration ou au risque de ne pas obtenir l’objet désiré, souvent associée à la castration symbolique et au complexe œdipien.
- L’angoisse de l’être : touche à la survie psychique, à la menace de dislocation du soi, fréquente dans les pathologies psychotiques.
- L’angoisse de la perte : concerne l’incertitude de conserver ce qui a été acquis ou offert, comme l’amour ou la protection d’autrui.
Ces formes sont universelles, mais se manifestent différemment selon l’histoire, la constitution et le contexte du sujet. Elles motivent souvent le recours à la psychanalyse, en quête de compréhension et de transformation.
Conclusion : une expérience universelle et singulière
L’angoisse est à la fois universelle et singulière. Universelle, car elle traverse toutes les existences humaines ; singulière, car chacun la vit à sa manière. Elle est au centre du discours analytique et clinique, révélant le lien entre désir, perte, liberté et responsabilité. Comprendre ses manifestations, ses racines philosophiques et ses implications psychiques permet non seulement de mieux la saisir, mais aussi d’accompagner les sujets qui viennent chercher dans l’analyse des réponses à cette expérience fondamentale.
Sources : KAPSAMBELIS, Vassilis, L’angoisse – Que sais-je – 5ème éditions PUF, 2022.